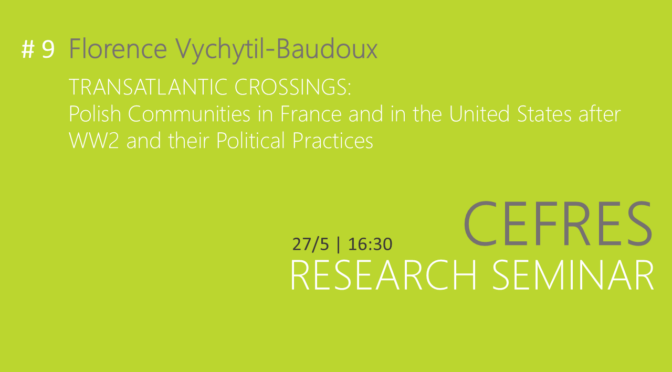Les Polonais en France et aux Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale et leurs pratiques politiques
9ème session du Séminaire interne du CEFRES 2024-2025
Par la présentation de recherches en cours, l’objectif du Séminaire du CEFRES est de soulever et de soumettre à la discussion des questions de méthodes, d’approches ou de concepts, dans un esprit pluridisciplinaire, permettant à chacun de croiser ses propres perspectives avec les travaux présentés.
Lieux : bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 et en ligne (pour obtenir le lien, écrivez à cefres(@)cefres.cz)
Date : mardi 27 mai 2025, 16 h 30
Langue : anglais
Intervenante : Florence Vychytil-Baudoux (EHESS / CEFRES)
Discutante: Françoise MAYER
Texte à lire : Michael Werner & Bénédicte Zimmermann, « Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity », History and Theory, 2006, vol. 45, no 1, p. 30‑50.
Résumé :
Entre les années 1880 et les années 1930, plus de 12 millions de personnes quittent les territoires polonais « za chlebem » (pour du pain). Si les Etats-Unis attirent la plupart des paysans polonais en quête d’un avenir meilleur avant la Première Guerre mondiale, la France constitue en revanche le premier pays d’accueil des immigrés polonais durant l’entre-deux-guerres.
Dans ces deux pays, comme dans tant d’autres, l’immigration polonaise donne lieu au développement d’une intense vie communautaire qui a attiré l’attention de nombreux sociologues et historiens. Leurs approches portent cependant le plus souvent la marque du nationalisme méthodologique. Les efforts pour « se libérer du corset de l’Etat-nation » (Walaszek, 2001) ne consistent en effet généralement qu’en une simple association d’articles embrassant les frontières de l’Etat-nation comme unité d’analyse « naturelle », vaguement tenus ensemble au moyen d’une introduction générale. La plus-value heuristique de ces accumulations de données, si impressionnantes soient-elles, est faible voire nulle : elles contribuent non seulement à naturaliser les Etats d’accueil comme espaces de référence, mais tendent aussi à subsumer les expériences polonaises à l’étranger sous l’étiquette « diaspora » (ou la catégorie émique – « Polonia ») et à essentialiser l’identité polonaise (immigrée).
Bien que les connexions et interactions entre les communautés polonaises établies dans différents pays soient restées largement hors du champ des « comparaisons divergentes » (Green, 2004), seule une approche relationnelle permet de comprendre les transformations observables en France et aux Etats-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale et au cours de la Guerre froide. Bien que les systèmes politiques de leurs Etats d’accueil respectifs diffèrent grandement, les Polonais adoptent en effet de part et d’autre de l’Atlantique des idées et des pratiques étonnamment proches dans le but d’accroître leur influence politique. Localiser et analyser les interactions entre ces deux communautés permet de mettre en lumière les dimensions dialectiques translocales des processus de transformation à l’œuvre ; de fait, les stratégies et pratiques politiques déployées localement sont élaborées sur la base de normes et de valeurs issues de représentations collectives connectant des espaces et des temporalités multiples.
Tout en résistant à la double tentation du nationalisme méthodologique et du transnationalisme, une approche relationnelle « du particulier et du local » peut enfin contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives épistémologiques et conceptuelles : en ce qu’elle donne à voir les relations ambivalentes entre discours nationaux et diasporiques, cette approche permet en effet de discuter voire de déconstruire les acceptions normatives de catégories émiques telles que « Polonia ».
Voici le programme complet du séminaire en 2024–2025 ici.