Ce colloque international réunit à Prague des chercheurs issus de toute l’Europe. L’une de ses ambitions principales est de créer un réseau centre-européen de spécialistes qui travaillent sur la question des relations entre l’homme et l’animal en croisant les disciplines.
Organisatrices : Dr. Chiara Mengozzi (CEFRES & FF UK) en coopération avec Dr. Anna Barcz (Université de Bielsko-Biala, Pologne)
Langue : anglais, français avec traduction en anglais
Programme
7 février 2017 – Institut français de Prague
Štĕpánská 35, 5e étage
17-17:30 Mot de bienvenue des organisatrices, Chiara Mengozzi (CEFRES & Université Charles) et Anna Barcz (Université de Bielsko-Biala)
 17:30-19:00 Conférence par Anne Simon (CNRS/EHESS): Littérature et expressivité animale : sur les enjeux cognitifs et éthiques de la zoopoétique
17:30-19:00 Conférence par Anne Simon (CNRS/EHESS): Littérature et expressivité animale : sur les enjeux cognitifs et éthiques de la zoopoétique
8 février 2017 – CEFRES
Na Florenci 3, 3e étage, salle de conférence
Session I : Biographie, histoire et micro-histoire des animaux
Modératrice : Lucie Storchová ( Université Charles)
9:00-9:20 Maria Gindhart (Georgia State University) : Animaux et humains dans les cartes postales Belle Époque de la Ménagerie du Jardin des Plantes
9:20-9:40 Violette Pouillard (Wiener-Anspach Post-Doctoral Fellow, University of Oxford) : Animaux non humains : objets ou individus ? Une histoire des primates au Zoo de Londres de 1828 au présent
9:40-10:00 Discussion
10:00-10:20 Pause café
Session II : Lignes littéraires I
Modératrice : Alice Flemrová
10:40-11:00 Chiara Mengozzi (CEFRES & Université Charles): L’angle mort de l’intrigue : Penser au delà de l’humain avec Karel Capek
11:00-11:20 Matilde Accurso Liotta (Université de Pise) : La renégociation de la ligne entre l’humain et l’animal dans L’iguana d’Anna Maria Ortese
11:20-11:40 Discussion
Conférence
11:40-12:50 Conférence de Kari Weil (Wesleyan University) : Magnétisme animal et dressage moral : les chevaux et leurs humains dans la France du XIXe siècle
12:50-14:00 Déjeuner
Session III : Récits philosophiques et sociologiques
Modérateur : Ondřej Švec (Université Charles)
14:00-14:20 Kári Driscoll (Université d’Utrecht) : Une langue ou une musique inouïe, assez inhumaine…’: la voix narrative et la question de l’animal
14:20-14:40 Michał Krzykawski (Université de Silésie) : Animal, Nombre
14:40-15:00 Tereza Vandrovcová (Université de New York, Prague) : L’évolution morale vers les habitants de la terre : une approche sociologique
15:00-15:20 Discussion
15:20-15:40 Pause café
Session IV Lignes visuelles I
Modératrice : Anna Barcz (University of Bielsko-Biala)
15:40-16:00 Olivier Vayron (Université Paris-Sorbonne) : De Frémiet à Kipling : l’orang-outan à la limite de l’humanité
16:00-16:20 Fae Brauer (Université de East London) : Devenir simien: l’évolution créative et le modernisme entre les espèces
16:20-16:40 Discussion
9 février 2017 – Institut français de Prague
Štĕpánská 35, 5e étage
Session V Session IV Lignes visuelles I : Histoire animale-humaine
Modératrice : Kari Weil
9:00-9:20 Quentin Montagne (University of Rennes 2) : Voir de la même façon, clairement à travers une vitre ? Le brouillage de la frontière entre hommes et animaux
9:20-9:40 Anna Barcz (Université de Bielsko-Biala) : Visualiser le lien humain-animal pendant la Grande Inondation 1997-2010 en Pologne
9:40-10:00 Discussion
10:00-10:20 Pause café
Session VI : Lignes visuelles II
Modérateur : Clara Royer (CEFRES)
10:20-10:40 Concepción Cortés Zulueta (Université autonome de Madrid) : Des caméras-animaux : imaginer les animaux non humains en filmant d’après point de vue
10:40-11:00 Discussion
Conférence
11.20-12:20 Conférence d’Éric Baratay (Université Jean Moulin Lyon III) : Écrire des biographies sur les animaux (en français, traduction simultanée en anglais)
12:30-13:30 Déjeuner
Session VII Lignes littéraires II
Modérateur : Richard Müller (Académie des sciences de République tchèque)
13:30-13:50 Anita Jarzyna (Université Adam Mickiewicz, Poznań) : La berceuse de Laika
13:50-14:10 Nicolas Picard (Université Paris 3) : Pratiques de la chasse : en quête des existences animales
14:10-14:30 Eva Beránková (Université Charles) : Les animaux victimes et monstres de la décadence
14:30-14:50 Discussion
14:50-15:10 Pause café
Session VIII Les animaux dans la culture populaire
Modératrice : Anne Simon (CNRS / EHESS)
15:10-15:30 Lenka Svobodová, Ondřej Krajtl (Université Masaryk) : L’animal monstrueux, topos de la représentation dans la culture contemporaine
15:30–15:50 Catherine du Toit (Université de Stellenbosch) : Il ne sied pas au cochon de reprocher à la bergerie d’être sale. Identité et animalité dans la fiction criminelle multiethnique
15:50-16:10 Discussion
Session IX : Lignes littéraires III
Modérateur : Jan Matonoha (Académie des sciences de République tchèque)
16:10-16:30 Jana Gridneva (Université Charles) : Créatures liminaires : Représenter les animaux dans Ulysse
16:30-16:50 Jonathan Pollock (Université de Perpignan) : De devenir animal à être une bête. Expériences littéraires par-delà la division des espèces
16:50-17:10 Enrico Riccardo Orlando (Université Ca’ Foscari, Venise) : Entre silence et effusions : le renard de Garnett et le thon de Bacchelli
17:10-17:30 Discussion
Conclusions
Comité scientifique
Éric Baratay (Université Jean Moulin Lyon III)
Anna Barcz (Université de Bielsko-Biala)
Jakub Čapek (Université Charles)
Chiara Mengozzi (CEFRES et Université Charles)
Anne Simon (CNRS/EHESS)
Petr Urban (Académie des sciences de la République tchèque)
Voir l’appel à communication ici


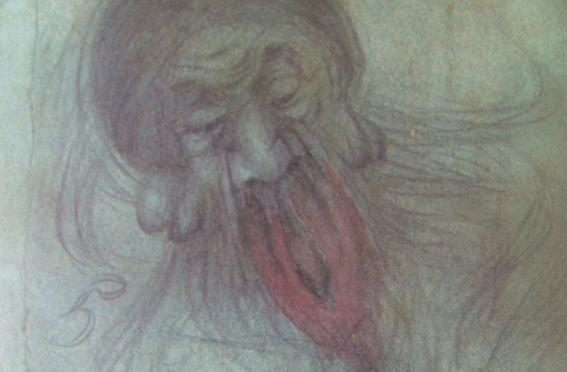

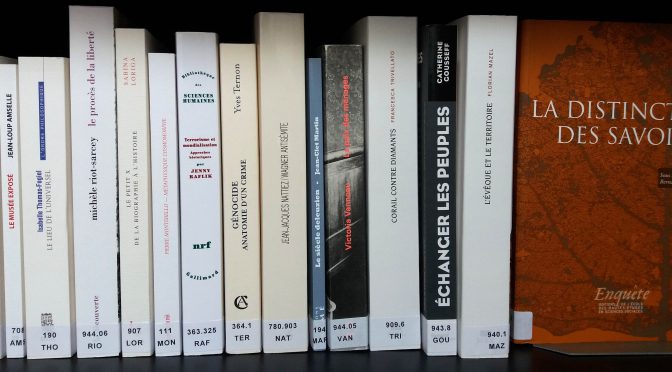

 Une conférence de Philippe Descola organisée par l’Institut de Philosophie de l’Académie des Sciences et le CEFRES avec la coopération de l’Institut français de Prague.
Une conférence de Philippe Descola organisée par l’Institut de Philosophie de l’Académie des Sciences et le CEFRES avec la coopération de l’Institut français de Prague.