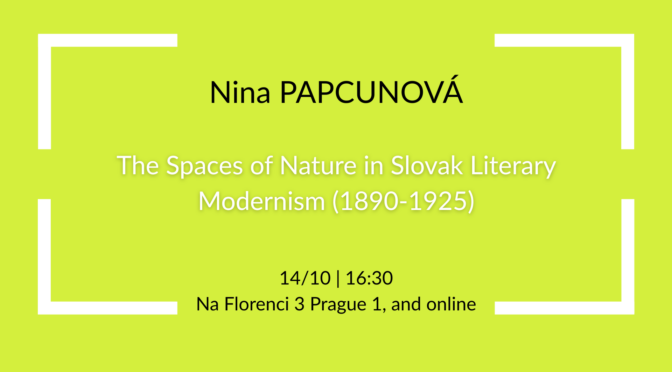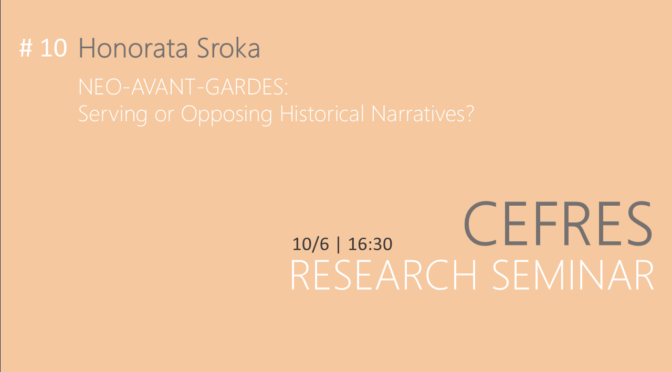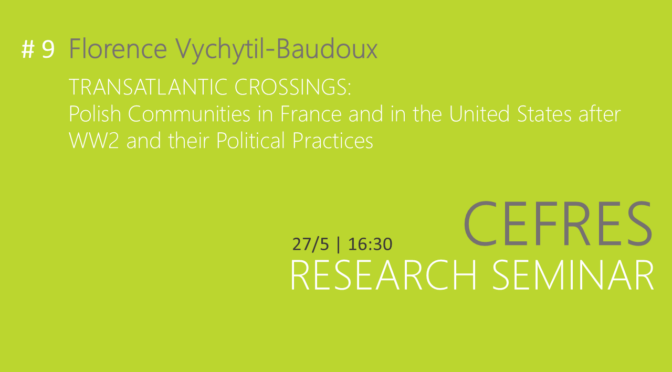Georges Didi-Huberman et quatre photographies d’août 1944
Deuxième session du Séminaire interdisciplinaire francophone du CEFRES 2025-2026 : Dépaysement : traces & trajectoires.
En 2023, nous avons commencé par interroger l’acte même de délimiter et de représenter (un territoire, une période, une trajectoire), bref, à l’aide du feu croisé de nos disciplines respectives, interroger la carte et la frontière.
Lieu : CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1
Date : vendredi 28 novembre 2025, à 10 h
Langue : français
Intervenant : Marek KETTNER (Université de Plzeň)
Discutante : Fedora PERKMANN (Institut d’histoire de l’art de l’Académie tchèque des sciences / associée au CEFRES)
Résumé
Georges Didi-Huberman conçoit l’imagination comme un montage d’images créant des images dialectiques complexes. Dans son livre Images malgré tout, il explore l’histoire de quatre photographies exceptionnelles d’Auschwitz. Au moment où l’auteur écrit son livre, grâce à de nouveaux témoignages et à des découvertes d’archives, ces traces visuelles de la Shoah s’ouvrent à de nouvelles interprétations, dans lesquelles l’imagination joue un rôle essentiel. Selon l’auteur, il n’y a pas de connaissance historique sans imagination. Mais l’imagination seule ne peut fonctionner sans traces visuelles, comprises ici comme des moments singuliers d’un processus temporel irréconstructible. S’il n’est pas possible de reconstruire les événements historiques, il est néanmoins possible de construire des images dialectiques, des montages de traces visuelles individuelles qui présentent un événement donné sous un jour nouveau, souvent surprenant. Avec son concept d’image dialectique, Didi-Huberman s’inscrit dans la lignée de Walter Benjamin, mais s’en distingue sur des points essentiels, comme le montre peut-être le mieux son livre Images malgré tout.
Voyez le programme complet du séminaire 2025–2026 ici.

Première session du Séminaire interdisciplinaire francophone du CEFRES 2025-2026 : Dépaysement : traces & trajectoires.
En 2023, nous avons commencé par interroger l’acte même de délimiter et de représenter (un territoire, une période, une trajectoire), bref, à l’aide du feu croisé de nos disciplines respectives, interroger la carte et la frontière.
Lieu : CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1
Date : vendredi 17 octobre 2025, à 10 h
Langue : français
Intervenant : Hugo MOSNERON-DUPIN (Doctorant en philosophie économique à l’ENS – PSL et au CIRED)
Discutant : Jan MARŠÁLEK (FLÚ AVČR)
Résumé
L’échange écologiquement inégal est un concept qui entend matérialiser les théories critiques du développement en faisant ressortir les conséquences environnementales et territoriales des inégalités de richesses entre les pays. Aux théories de l’échange inégal qui tentent d’expliquer le blocage de certaines économies dans un modèle d’export de biens à faible valeur ajoutée, elles ajoutent une évaluation non plus économique mais physique de ces échanges internationaux : les pays les plus développés drainent les ressources naturelles notamment énergétiques des pays les moins développés en capturant une portion de ces territoires pour les dédier à l’économie d’export. De ce fait la notion d’échange écologiquement inégal permet d’interroger le dépaysement dans une double direction : d’abord l’export constitue au sens littéral un dépaysement, un transfert hors des frontières d’une entité qui transporte avec elle une dimension – ici écologique – de son pays d’origine ; ensuite la transformation d’un territoire pour produire des denrées qui seront vendues à l’étranger peut être considérée comme un dépaysement non plus seulement des biens mais du territoire producteur lui-même. En effet, la théorie de l’échange écologiquement inégal montre que ces territoires peuvent être considérés comme des enclaves écologiques du pays importateur dans le pays exportateur. Nous conduirons ces réflexions en nous appuyant sur une lecture croisée d’Underdeveloping the Amazon (Stephen Bunker, 1987) **- ouvrage fondateur de cette approche – et d’une étude concrète d’échange écologiquement inégal sur l’exploitation intensive de crevettes en Equateur par l’écologue Howard Odum (1991).
Voici le programme complet du séminaire en 2025–2026
ici.
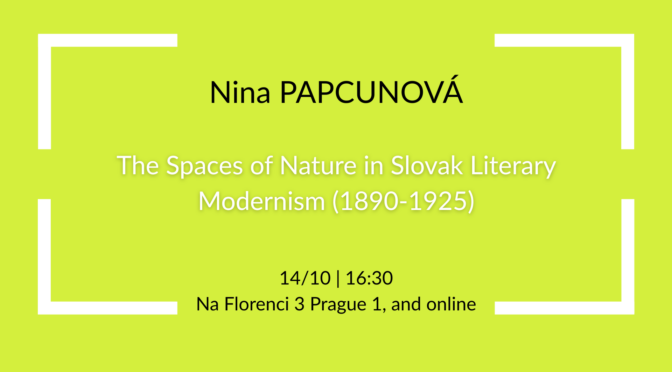
2ème session du Séminaire interne du CEFRES 2025-2026
Par la présentation de recherches en cours, l’objectif du Séminaire du CEFRES est de soulever et de soumettre à la discussion des questions de méthodes, d’approches ou de concepts, dans un esprit pluridisciplinaire, permettant à chacun de croiser ses propres perspectives avec les travaux présentés.
Lieu : bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 et en ligne (pour obtenir le lien, écrivez à cefres(@)cefres.cz)
Date : mardi 14 octobre 2025, 16 h 30
Langue : anglais
Intervenant : Nina PAPCUNOVÁ (CEFRES / SAS)
Discutante : Eva KRÁSOVÁ (CEFRES / Université Charles)
Résumé Continuer la lecture de Espaces de la nature dans la littérature slovaque du modernisme (1890-1925) →

1ère session du Séminaire interne du CEFRES 2025-2026
Par la présentation de recherches en cours, l’objectif du Séminaire du CEFRES est de soulever et de soumettre à la discussion des questions de méthodes, d’approches ou de concepts, dans un esprit pluridisciplinaire, permettant à chacun de croiser ses propres perspectives avec les travaux présentés.
Lieu : bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 et en ligne (pour obtenir le lien, écrivez à cefres(@)cefres.cz)
Date : mardi 23 septembre 2025, 16 h 30
Langue : anglais
Intervenant : Andrej VAŠÍČEK (CEFRES / FiF UK)
Discutante : Markéta ŠANTRŮČKOVÁ (Department of Cultural Landscape and Sites, Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening – VUKOZ v.v.i)
Résumé
Ce séminaire aborde le paysage sacré comme un réseau dynamique de lieux et de routes façonné par la piété baroque, la réorganisation diocésaine et les pratiques quotidiennes. Elle combine la géographie historique par l’usage d’un système d’information géographique reconstituant comment les églises, les chapelles, les calvaires, les croix et les cimetières forment les hiérarchies spatiales et les itinéraires. Les sources cartographiques sont interprétées et recoupées avec des visites canoniques, des schémas, des registres municipaux et paroissiaux, l’épigraphie et l’observation de terrain. L’exemple circonscrit de la ville de Púchov montre les seuils hydrologiques et de transport, le transfert des cimetières en dehors de la ville et le pouvoir de datation des chronogrammes. Le séminaire propose une approche transférable pour la reconstitution historico-géographique des couches sacrées en Europe centrale et réfléchit à ses applications pratiques dans la gestion du patrimoine, l’aménagement du territoire et l’engagement public.
Voici le programme complet du séminaire en 2025–2026 ici.
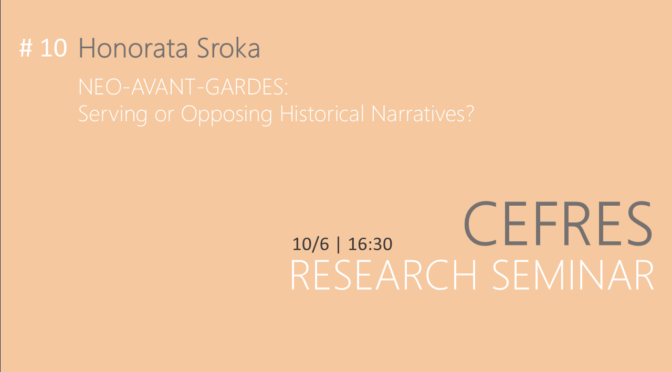
10ème session du Séminaire interne du CEFRES 2024-2025
Par la présentation de recherches en cours, l’objectif du Séminaire du CEFRES est de soulever et de soumettre à la discussion des questions de méthodes, d’approches ou de concepts, dans un esprit pluridisciplinaire, permettant à chacun de croiser ses propres perspectives avec les travaux présentés.
Lieux : bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 et en ligne (pour obtenir le lien, écrivez à cefres(@)cefres.cz)
Date : mardi 10 juin 2025, 16 h 30
Langue : anglais
Intervenante : Honorata Sroka (CEFRES / Université Charles)
Discutante : Hélène Martinelli(CEFRES / École normale supérieure de Lyon)
Texte à lire : Peter Bürger (1974). Theory of the Avant-Garde. Translation Michael Shaw. Manchester: Manchester University Press.
Abstract
La présentation prendra la forme de remarques préliminaires concernant l’état de mes recherches post-doctorales, que je mène désormais depuis sept mois au sein du Centre français de recherche en sciences sociales. Mon projet s’inscrit dans la continuité de ma thèse de doctorat, mais constitue une approche élargie de celle-ci. En m’appuyant en particulier sur l’exemple des néo avant-gardes d’Europe centrale et orientale, j’espère montrer comment et pourquoi les artistes prennent la décision de produire des formes subversives d’historiographies en m’appuyant sur différents types de stratégies expérimentales extraites des archives.
Employant la méthodologie dîtes de « l’histoire culturelle des avant-gardes », je concentre mon attention sur les institutions et les pratiques orientées vers l’auto-historiographie d’avant-garde. Ce que j’ai la présomption d’affirmer au travers de ces recherches invite essentiellement à une réflexion sur l’ouvrage-clef de Peter Bürger, Théorie de l’Avant-garde (1974). Celui-ci affirmait que les avant-gardes se dressaient vent-debout contre les institutions établies du monde de l’art. Au contraire de cette idée, mes recherches conduisent à montrer comment les néo avant-gardes en Europe centrale et orientale développaient – plus qu’elles détruisaient – les institutions du domaine de l’art, tout autant que les formes subversives de l’historiographie, illustrant ce faisant leur interdépendance mutuelle à l’époque contemporaine.
Voici le programme complet du séminaire en 2024–2025 ici.
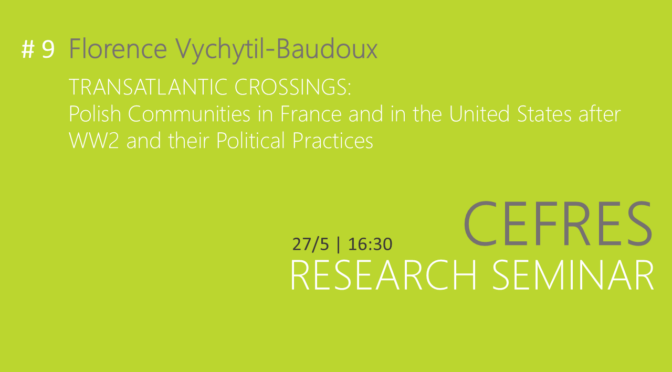
Les Polonais en France et aux Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale et leurs pratiques politiques
9ème session du Séminaire interne du CEFRES 2024-2025
Par la présentation de recherches en cours, l’objectif du Séminaire du CEFRES est de soulever et de soumettre à la discussion des questions de méthodes, d’approches ou de concepts, dans un esprit pluridisciplinaire, permettant à chacun de croiser ses propres perspectives avec les travaux présentés.
Lieux : bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 et en ligne (pour obtenir le lien, écrivez à cefres(@)cefres.cz)
Date : mardi 27 mai 2025, 16 h 30
Langue : anglais
Intervenante : Florence Vychytil-Baudoux (EHESS / CEFRES)
Discutante: Françoise MAYER
Texte à lire : Michael Werner & Bénédicte Zimmermann, « Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity », History and Theory, 2006, vol. 45, no 1, p. 30‑50.
Résumé :
Entre les années 1880 et les années 1930, plus de 12 millions de personnes quittent les territoires polonais « za chlebem » (pour du pain). Si les Etats-Unis attirent la plupart des paysans polonais en quête d’un avenir meilleur avant la Première Guerre mondiale, la France constitue en revanche le premier pays d’accueil des immigrés polonais durant l’entre-deux-guerres. Continuer la lecture de Traversées transatlantiques | ANNULÉ →