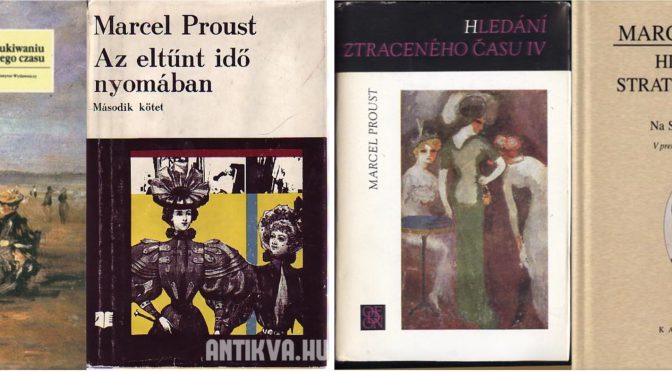Table ronde internationale : La traduction du français en Europe centrale au XXe siècle : contexte politique et culturel (Hongrie, Pays tchèques, Pologne, Slovaquie)
Où : Institut des Littératures étrangères de l’Académie slovaque des sciences, Konventn á 13, Bratislava
á 13, Bratislava
Comité d’organisation : Antoine Marès (Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), Clara Royer (CEFRES Prague), Jana Truhlářová (Université Comenius de Bratislava), Mária Kusá (Institut de Littératures étrangères de l’Académie slovaque des Sciences), Petr Kyloušek (Université Masaryk de Brno)
Initiateur : UMR SIRICE (axe 2), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, programme « Construction des savoirs réciproques sur l’Europe médiane en France et sur la France en Europe médiane »
Partenaires : CEFRES de Prague, Université Comenius de Bratislava, Académie slovaque des sciences, Université Masaryk de Brno, Gallica, Ambassade de France à Bratislava
Programme
Mardi 16 mai
9h – 9h15 Allocutions d’ouverture de la Table ronde internationale:
Mot d’accueil de l’Institut français de Bratislava
Jaroslav Šušol, doyen de la Faculté des Lettres de l’Université Comenius de Bratislava
Adam Bžoch, directeur de l´Institut de Littératures étrangères de l’Académie slovaque des Sciences
9h15 – 9h30 Introduction
Antoine Marès (Paris1 Panthéon-Sorbonne): Histoire d’un projet
9h30 Gisèle Sapiro (EHESS): intervention présentée par Clara Royer
10h00 Ioana Popa (ISP, CNRS): Une sociologie des intermédiaires culturels internationaux: transferts littéraires vers la France en contexte (post)-communiste
10h30 – 11h00 Pause – café
11h – 13h Session I. Contexte historique des quatre espaces culturels concernés : Héritages et traditions ; Le rapport à la culture française ; Contraintes matérielles et politiques
Modérateur : Antoine Marès (Paris1 Panthéon-Sorbonne)
11h Bohumila Ferenčuhová (Institut d’Histoire – SAV) : Le contexte historique et politique des relations culturelles slovaco-françaises au XXe siècle
11h30 Jiří Hnilica (Département d’Histoire, Faculté de pédagogie de l’Université Charles, Prague) : Les tendances quantitatives des livres traduits du français en tchèque (et slovaque) aux XIXe et XXe siècles
12h Gusztáv Kecskés (Institut d’histoire, MTA, Budapest) : Des possibilités de transferts culturels français en Hongrie, 1945-1990
12h30 Maria Pasztor (Institut des relations internationales, Université de Varsovie) : Les relations culturelles entre la France et la Pologne (1945-1989)
13:00 -14:30 Déjeuner – buffet à l’Institut de Littératures étrangères
14h30 – 18h30 Session II. Les acteurs de la traduction : Traducteurs, Éditeurs, Médiateurs
Modératrice : Jana Truhlářová (Université Comenius de Bratislava)
14h30 Éva Mártonyi (Université de Pécs et Université catholique Pázmány Péter) : Traductions du français en Hongrie – aperçu historique
15h Jovanka Šotolová (Institut de traductologie, Université Charles) : Par monts et par vaux des traductions tchèques de la littérature française : les flux des oeuvres traduites, la question du rapport entre la qualité et l’influence
15h30 Katarína Bednárová (Université Comenius) : Le critique littéraire comme modificateur de traduction
16h00 – 16h30 Pause – café
16h30 Anikó Ádám (Université Catholique Pázmány Péter) : La difficile liberté du traducteur
17h Petr Kyloušek (Université Masaryk, Brno) : Les contacts français d’Adolf Kroupa – Archives du Musée morave, fonds Kroupa
18h30 Cocktail dînatoire à l’Institut français de Bratislava, rue Sedlárska 2
Mercredi 17 mai
9h – 12h30 Session III. Les flux de traduction: quantification des flux; nature des flux (littérature et autres); influence des flux : question du rapport entre quantité et influence
Modérateur : Petr Kyloušek (Université Masaryk de Brno)
9h Elzbieta Skibińska (Université de Wroclaw) : Le Nouveau roman en polonais
9h30 Joanna Warmuzińska-Rogóź (Université de Silésie, Katowice): D´une Maria Chapdelaine à l´autre ou quelques mots sur le marché de traduction en Pologne
10h Mária Kusá (Université Comenius, Institut de Littératures étrangères de l’Académie slovaque des Sciences): Réflexions en marge du travail sur Le Dictionnaire des traducteurs slovaques du XXe siècle
10h30 – 11h Pause – café
Modératrice: Clara Royer (CEFRES Prague)
11h00 Libuša Vajdová (Institut de Littératures étrangères de l’Académie slovaque des Sciences): Les sciences sociales de France en Slovaquie
11h30 Jana Truhlářová (Université Comenius de Bratislava): Le sort de certains romanciers et mouvements esthétiques français du XIXe siècle (Flaubert, Zola et le naturalisme, Maupassant) à travers le temps en Slovaquie
12h00 Zuzana Ráková (Université Masaryk de Brno): Éditeurs, traducteurs, auteurs français en traductions tchèques publiées par les éditeurs tchèques à la Belle époque (1890-1914)
12h30 – 12h40 Pause – café
Conclusions
Antoine Marès, Clara Royer, Jana Truhlářová, Mária Kusá, Petr Kyloušek
13h00 Déjeuner – buffet à l’Institut de Littératures étrangères
Argumentaire
En quoi les traductions peuvent-elles intéresser l’histoire des relations internationales et des échanges internationaux ? Ni l’historien de la littérature, qui étudie le contenu et le destin des œuvres littéraires, ni le comparatiste, qui s’occupe de la réception et des influences entre littératures, ne répondent pleinement à ses préoccupations, même si les travaux des romanistes, des historiens de la littérature et des comparatistes centre-européens constituent un matériau précieux à manier avec profit par les « internationalistes » et si leurs approches, à partir du moment où elles intègrent le contexte, sont très précieuses. Les contenus littéraires, la qualité des traductions et les problèmes qu’elles soulèvent, évoqués par les différentes théories de la traduction, seront donc secondaires ici. En revanche, les apports des historiens du culturel sont fondamentaux, avec en particulier la notion de « transferts culturels » ; il en est de même pour les problématiques soulevées par les sociologues de la littérature ou de la culture. La notion d’espaces littéraires différents est également importante, avec le rapport entre un espace littéraire mondial et les effets de frontière, tout comme les relations entre centres et périphéries (avec la notion de capitale littéraire), qui peuvent être riches en pistes de recherche[1].
Ce sont donc les flux de traduction, les acteurs, les contacts, les réseaux, les médiations qui seront privilégiés au cours de cette rencontre qui réunira des historiens, des sociologues et des littéraires. Il s’agira d’une part de faire le point sur les travaux existants concernant la traduction du français en Europe centrale : au-delà du précieux état des lieux que nous en attendons pays par pays, c’est la comparaison entre les quatre espaces nationaux abordés qui sera fondamentale. Par ailleurs seront posées et analysées dans leurs développements historiques tout au long du 20e siècle (principalement entre 1918 et 1990) un certain nombre de questions :
- Pourquoi édite-t-on des livres traduits du français vers une langue d’Europe centrale ?
- Quels sont les mécanismes complexes qui régissent ce processus et les enjeux ?
- Quels en sont les émetteurs, les médiateurs et les récepteurs ?
- Et comment cela traduit-il des flux internationaux, idéologiques et intellectuels, qui dépassent le champ littéraire ?
[1] Christophe Charle, Les intellectuels en Europe au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2001 ; Michel Espagne, Le paradigme de l’étranger, Paris, Les éditions du Cerf, 1993 ; Pascal Ory, L’histoire culturelle, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2010 ; Michel Espagne, Michael Werner, Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco-allemand (XVIIIe-XIXe siècle), Paris, Éditions recherches sur les civilisations, 1988. Voir les travaux de Gisèle Sapiro (par exemple http://www.lemotif.fr/fr/etudes-et-donnees/etudes- du-motif/etude-paris-new-york-paris/) et Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, coll. « Points », 2008. Sur un sujet proche, mais inverse à celui traité ici, Ioana Popa, Traduire sous contraintes. Littérature et communisme (1947-1989), Paris, CNRS Éditions, coll. « Culture et sociétés », 2010 ; Ioana Popa, « Le réalisme socialiste, un produit d’exportation politico-littéraire », Sociétés & Représentations 1/2003, n° 15, p. 261-292.