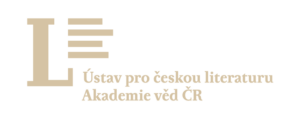Pratiques de traduction et d’édition dans la réception de la littérature belge dans les espaces culturels tchécophones et germanophones durant le modernisme (1870-1940)
Ce workshop est organisé par Petra James, Hubert Roland, Quintus Immisch di Padua and Martina Mecco, MODERNITAS (MSH – Université Libre de Bruxelles) – UCLouvain et le CEFRES – Centre français de recherche en sciences sociales en collaboration avec le Département de littérature comparée et tchèque, Université Charles, Institut de littérature tchèque, AV ČR, Institut de littérature slovaque, SAV.
PDR Project, Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS:
“Belgium ‘Read’ in German and Czech” (2024-2027)
Date limite de d’envoi des propositions : 30 décembre 2025
Date : 15–17 avril 2026
Lieu : CEFRES, Prague
Langues : anglais, français, tchèque, allemand
Envoyez un abstract de 300 mots à l’adresse suivante: martina.mecco@ulb.be
Le colloque est organisé dans le cadre du projet de recherche FNRS (Le Fonds de la Recherche Scientifique, Belgique) intitulé « La Belgique ‘lue’ en tchèque et en allemand » (2024-2027), dirigé par Petra James (Université libre de Bruxelles) et Hubert Roland (Université Catholique de Louvain-la-Neuve).
L’argumentaire
Durant la période moderniste (environ 1880–1940), la Belgique, le contexte tchécophone et les espaces germanophones ont vu se développer un système dynamique et florissant de médiation culturelle réciproque, caractérisé par une intensification des pratiques de traduction, soutenue par l’activité des revues, maisons d’édition et institutions culturelles. Entre les XVIIIe et XIXe siècles, ces régions ont connu un processus d’autonomisation des champs littéraires et artistiques (Bourdieu 1992 ; Casanova 2008 ; Sapiro 2023). Des études récentes ont mis en lumière les limites du modèle bourdieusien, en questionnant notamment sa pertinence au-delà du contexte français, ainsi que les relations complexes entre autonomie et hétéronomie (Šebek 2019 ; Albers – Hahn – Ponten 2022 ; Hrdina 2024 ; Robert 2024). Le contexte belge appelle en particulier une relecture critique à la suite de Paul Aron, qui conteste la qualification du champ littéraire belge comme simple « sous-champ » du champ français (Aron 1999 ; Durand – Habrand 2018).
Les activités de médiation ont joué un rôle central dans le processus d’autonomisation des champs littéraires nationaux. À cet égard, l’historiographie critique a largement marginalisé les médiatrices, en dépit de leur rôle crucial. À première vue, les réseaux de médiation semblent dominés par des figures masculines (Géry 2020). Dans l’Europe des XIXe et XXe siècles, la position des femmes créatrices – écrivaines, traductrices, éditrices, journalistes, etc. – demeurait profondément précaire. Comme l’a souligné Libuše Heczková (2009) à propos de la Bohême : « on appelait la femme à ‘aider’, et les hommes la considéraient comme une ‘sœur’ dans leurs actions divines ». Les études sur les transferts culturels liés à la réception de la littérature belge dans les contextes germanophones mettent souvent en avant des figures telles que Stefan Zweig et Otto Hauser, ou Karl Anton Klammer et Friedrich von Oppeln-Bronikowski. De même, dans le milieu tchèque, Otokar Fischer (Thirouin 2020) ou Václav Tille sont régulièrement mentionnés. Du côté belge, le rôle d’Henri Grégoire et de sa revue Le Flambeau dans la promotion de la culture slave est bien connu, mais, comme l’a rappelé Laurent Béghin (2014), cette médiation était étroitement liée à l’action de sa sœur, Junia Letty.
S’inscrivant dans la lignée théorique initiée par Elaine Showalter (1977) et poursuivie par la critique littéraire féministe, ce colloque entend déconstruire les récits androcentriques, en particulier dans les cadres multilingues et multiculturels de la période moderniste (voir la revue Feminist Modernist Studies). Il s’agit de remettre en lumière les contributions décisives de nombreuses figures féminines oubliées, telles que Marie Kalašová, traductrice de Maeterlinck, la critique littéraire Libuše Sobotková ou encore Lída Faltová, traductrice majeure de la littérature flamande vers le tchèque. Du côté germanophone, des figures comme Eva Rechel-Mertens, traductrice de Marie Gevers (van de Pol-Tegge 2025), ou Anna Valeton, traductrice de Stijn Streuvels, méritent une attention renouvelée.
La traduction n’est qu’un des mécanismes de ce vaste processus de transfert culturel. Dans le triangle moderniste constitué par les pôles germanophone, tchèque et belge, les revues (Joyeux-Prunel – Carboni – Barras 2024), maisons d’édition et institutions culturelles ont joué un rôle central. La médiation de la littérature belge en Bohême et dans les pays germanophones fut particulièrement intense. Dans les contextes germanophones, des revues comme PAN, Das literarische Echo ou Die Zeit à Vienne, furent des plateformes décisives. En Bohême, les publications telles que Osvěta, Rozpravy Aventina ou Prager Presse furent essentielles pour la réception de la littérature étrangère.
Le multilinguisme constitue un enjeu crucial dans les études de traduction et de transfert culturel (Meylaerts 2013). Dans cette constellation triangulaire, il est essentiel de penser les interactions non-binaires entre et au sein des sphères littéraires multilingues. La période moderniste fut marquée par une large diffusion de la littérature flamande, révélant de multiples négociations linguistiques, politiques et idéologiques. Les espaces tchécophones et germanophones furent, jusqu’en 1948, des centres majeurs de la réception de la littérature flamande en Europe centrale et orientale – en particulier dans les cercles catholiques tchèques, grâce notamment à Otto F. Babler (Engelbrecht 2014 ; Engelbrecht – Vaidová – Jančíková 2015), ou encore via les revues catholiques germanophones mais aussi dans le programme ambitieux de traduction de littérature flamande par l’éditeur du Insel-Verlag Anton Kippenberg. Ce processus s’intensifie dans les années 1920 avec la médiation d’auteurs flamands contemporains comme Felix Timmermans, largement traduit par Rudolf J. Vonka, ou August Vermeylen, traduit en 1926 par Otokar Fischer. En contexte germanophone, les traductions de littérature flamande à Vienne par Otto Hauser ou encore les politiques éditoriales inspirées de la Flamenpolitik (Roland 2013) furent également déterminantes.
Les contributions possibles pourront inclure, sans toutefois s’y limiter :
- Études de cas sur le rôle des femmes dans la construction, la médiation et la redéfinition de la réception de la littérature belge pendant le modernisme (1880er–1940er Jahre) dans les espaces culturels tchèque et germanophone. Les propositions issues des études de réception, des études de genre ou d’histoire littéraire comparée seront particulièrement bienvenues ;
- Rôle des revues, maisons d’édition et institutions culturelles dans la médiation de la littérature belge en Bohême et dans les pays germanophones, ainsi que les pratiques associées d’édition, de traduction et de diffusion ;
- Médiatrices, revues, maisons d’édition et institutions culturelles belges impliquées dans la réception de la littérature tchèque ou germanophone en Belgique durant la période moderniste ;
- Réception de la littérature flamande dans les contextes tchécophones et germanophones.
Cette triangulation géographique entre Belgique, espaces tchécophones et germanophones pourra être étendue à des contextes culturels voisins ou multilatéraux, incluant notamment les espaces slovaques, polonais, hongrois ou roumains. Les approches comparatives entre ces aires culturelles et les sphères tchèques ou germanophones sont particulièrement encouragées.
Comité scientifique : Marnix Beyen, Laurence Boudart, Elke Brems, Mateusz Chmurski, Clément Dessy, Michel Dumoulin, Jürgen Elvert, Libuše Heczková, Martin Hrdina, Dan Hučková, Christophe Meurée, Helga Mitterbauer, Sabine Schmitz, Alice Stašková, Stéphanie Vanasten.
Conférenciers invités : Paul Aron, Libuše Heczková, Mario Zanucchi