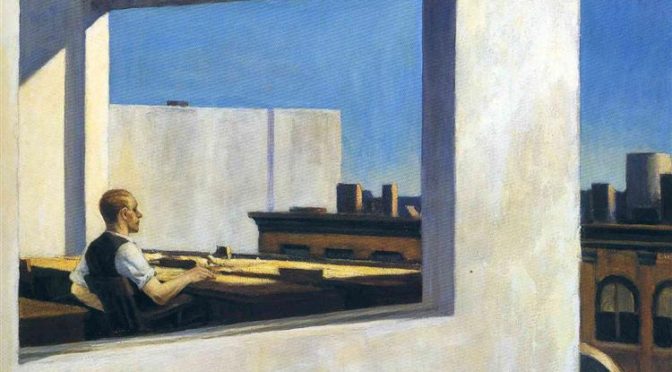Femmes dépaysées: trajectoires transnationales et expériences artistiques d’émancipation en Europe médiane
Organisateurs : Mateusz Chmurski, Clara Royer, Lola Sinoimeri
Dates et lieu : 16-17 mars 2023, CEFRES, Prague et en ligne
Date-limite d’envoi des propositions : 15 octobre 2022
Langues : français, anglais
Comité scientifique :
Anna Borgos (Académie des sciences hongroise, Budapest), Libuše Heczková (Université Charles), Luba Jurgenson (Sorbonne Université), Iwona Kurz (Univeristé de Varsovie), Jasmina Lukić (Central European University), Markéta Theinhardt (Sorbonne Université)
Partenaires : CEFRES (CNRS-MEAE), Eur’ORBEM (CNRS-Sorbonne Université), Institut de littérature tchèque et comparée, Université Charles (ÚČLK FF UK), Institut de la culture polonaise, Université de Varsovie (IKP WP UW) – avec le soutien de l’alliance universitaire européenne 4EU+, du GDR « Connaissance de l’Europe médiane » (CNRS) et de l’Institut français de Prague)
Programme complet.
Continuer la lecture de AAC – Femmes dépaysées: trajectoires transnationales et expériences artistiques d’émancipation en Europe médiane →