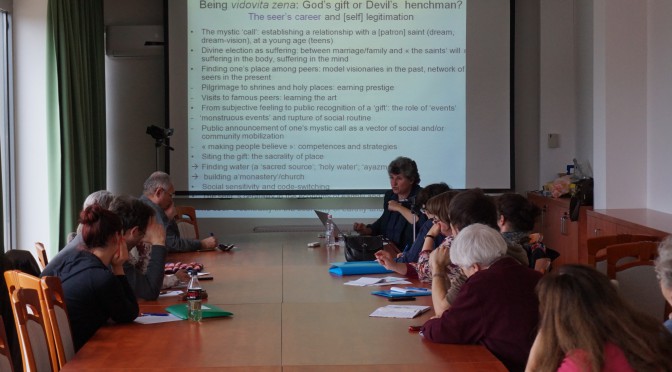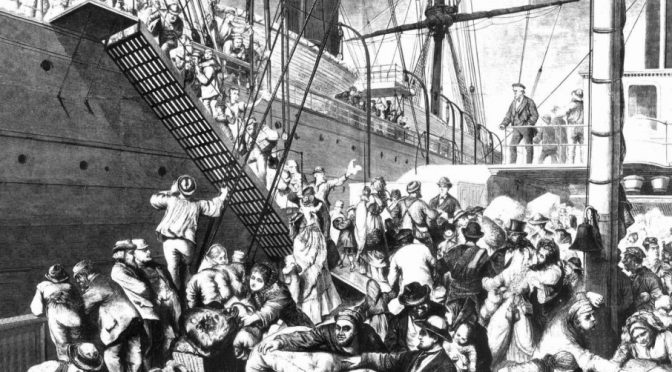Nous avons plaisir de vous inviter à un colloque international intitulé Usages pédagogiques du passé en Europe : circulations internationales, transferts, débats transnationaux.
Date : 11 au 12 octobre 2021
Lieu : Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, 74, rue Lauriston, 75016 Paris
Langue : français et anglais
Organisateurs : Académie polonaise des sciences (Centre scientifique à Paris, Centre de civilisation française, CEFRES)
L’établissement de nouveaux régimes en Europe centrale et orientale à la fin des années 1980 – ainsi que les changements
successifs de gouvernement – s’est opérée via de nouvelles narrations historiques, combinant les demandes
et les besoins de légitimation nationale, de réconciliation, de reconnaissance symbolique et l’imposition
de paradigmes démocratiques. Ces préoccupations se sont traduites par des dispositifs divers : discours solennels,
commémorations, lustrations, commissions ad hoc, dispositifs légaux, monuments, musées, mécanismes parmi lesquels
l’éducation tient une place singulière, en se voyant assignée la formation des futures générations de citoyens.
Le champ scientifique a longtemps négligé le traitement du passé à l’école et dans un contexte extracurriculaire.
Certes, l’analyse des instruments de l’action publique en matière d’enseignement de l’histoire a été investie par
la recherche, se concentrant toutefois essentiellement sur l’analyse des manuels. Elle reste portée, à quelques
exceptions près, par des chercheurs en sciences de l’éducation et, souvent, des didacticiens de l’histoire. L’analyse
des circulations internationales dans la gestion du passé à l’école s’est, elle, surtout focalisée sur les commissions
d’historiens, sans pourtant articuler leur action aux pratiques pédagogiques scolaires et para-scolaires
proprement dites. Or, l’école fait l’objet d’un grand nombre de transpositions, d’adaptations et / ou de (ré)appropriations
des dispositifs hérités d’échanges inter- et / ou transnationaux, voire globaux. Par exemple, de ceux nés
du travail de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe, de l’UE, des commissions bilatérales d’historiens, de l’enseignement
de la Shoah comme norme politico-morale, du recours à la figure du témoin ou des visites des « lieux de
mémoire » dans le cadre de la pratique pédagogique.
Ce colloque international se donne pour objectif de réexaminer les usages scolaires et para-scolaires du passé au
regard de ces circulations internationales, à partir d’une réflexion sur les différentes échelles d’analyse de ce phénomène
: de l’international au microscopique de la salle de classe. Il s’agit en effet de penser ces usages comme l’un
des vecteurs déterminants pour la construction des instruments et des pratiques pédagogiques à l’école et au-delà.
Une telle analyse suppose une réflexion sur les différents niveaux de ces dynamiques de circulation : autour des
transmetteurs et des diffuseurs d’idées et de savoirs, des conditions socio-politiques de leurs réceptions privilégiées,
de leurs inscriptions dans des espaces culturels et des réseaux internationaux, voire globalisés. Dans
cette perspective, il s’agira d’interroger le poids du passé dans des conflits mémoriels transnationaux dans une
Europe élargie ainsi que les ruptures et les continuités de la place assignée aux minorités. Cette conférence se
veut pluridisciplinaire, faisant appel à des réflexions issues notamment des sciences de l’éducation, de l’histoire,
des sciences politiques, de la sociologie.
Programme
Fr : Les interventions seront prononcées en français ou anglais sans traduction simultanée. Les titres indiquent la langue de l’intervention.
11 octobre 2021
9h15 : Accueil
9h45 : Introduction
Emmanuelle Hébert, Université de Namur, Université catholique de Louvain (ISPOLE)
Ewa Tartakowsky, Institut des sciences sociales du Politique (ISP), Centre de civilisation française et d’études francophones de l’Université de Varsovie (CCFEF)
10h00-12h00 : Construction européenne des savoirs
historiques
Chair / Présidence : Anne Bazin, Sciences Po Lille
Patrick Garcia, Université Versailles Saint-Quentin, Institut d’histoire du temps présent, L’évolution du statut de l’histoire dans le discours du Conseil de l’Europe
Włodzimierz Borodziej, Institute of History, University of Warsaw
Embracing the gaps. A very short history of the House of European History
Mathieu Kroon Gutierrez, Université Cergy-Pontoise, Université de Luxembourg, Transmission des savoirs historiques dans un contexte transnational : le cas des Écoles européennes
Discussion : Nicolas Maslowski, Centre de civilisation française et d’études francophones, Université de Varsovie
12h00-13h00 : Pause déjeuner
13h00-15h30 : Négociations bilatérales et réconciliation par histoire
Chair / Présidence : Sébastien Ledoux, Université de Paris 1, Centre d’histoire sociale des mondes contemporains
Anne Bazin, Sciences Po Lille, Historical Commissions: An Insight on Reconciliation Through Historical Dialogue
Steffen Sammler, Georg Eckert Institute, Quel cadre institutionnel pour une éducation à la réconciliation et la coopération en Europe ? Plaidoyer pour un nouveau forum de discussion.
Dirk Sadowski, Georg Eckert Institute, Textbook Talks Beyond Revision: The (second) German-Israeli Textbook Commission and its Activities.
Emmanuelle Hébert, Université de Namur, Université catholique de Louvain (ISPOLE), From the Battle of Thermopylae to WWII: Transfers, Circulations and Transnational Debates around
the Polish-German Schoolbook Project
Discussion : Jana Vargovčíková, INALCO
15h30-16h00 : Pause café
16h00-18h30 : Éducation à l’histoire, éducation civique ?
Présidence : Frédéric Zalewski, Université Paris Nanterre
Piero Colla, AGORA, Mémoires exemplaires et éducation aux valeurs : nouveaux usages scolaires du passé, en Suède et dans l’UE (2000–2020)
Sébastien Ledoux, Université de Paris 1, Centre d’histoire sociale des mondes contemporains, Les pédagogies de la mémoire s’européanisent-elles ?
Alexandra Oeser, Université Paris-Nanterre, Institut des Sciences Sociales du Politique, Politiques d’enseignement de la Shoah : la constitution de l’Allemagne comme référence internationale
Discussion : Valentin Behr, Institut d’études avancées de Paris
12 octobre 2021
10h00-12h00 : Enseigner l’histoire nationale : entre politiques publiques et mémoire sociale
Présidence : Ewa Tartakowsky, ISP, CCFEF
Tea Sindbæk Andersen, University of Copenhagen
Forging public memory. Yugoslav historical narratives in Bosnian, Croatian and Serbian schoolbooks
Olga Konkka, Université Bordeaux Montaigne, Centre d’Études des Mondes Moderne et Contemporain, Border Walls in History Education: Foreign Historiographies in Soviet and Post-Soviet Russian School History Textbooks
Hana Havlujova, Charles University, Enjoying National Heritage: Educational Use of the Past in the Czech Republic and Beyond
Discussion : Paul Gradvohl, Université Paris 1, Centre de recherche de l’histoire de l’Europe centrale
contemporaine
12h00-13h30 : Pause déjeuner
13h30-15h30 : Enseigner l’histoire dans des contextes nationaux à l’heure des circulations
internationales des pratiques pédagogiques
Présidence : Emmanuelle Hébert, Université de Namur, Université catholique de Louvain (ISPOLE)
Violetta Julkowska, Université Adam Mickiewicz
Historie rodzinne jako element szkolnej edukacji historycznej – źródła, metody pracy, praktyka szkolna w ujęciu
porównawczym [Traduction en français et/ou anglais sera assurée : Les histoires de famille comme élément de l’enseignement historique scolaire – sources, méthodes de travail, pratiques scolaires dans
une perspective comparative]
Edina Kőműves, ELTE Budapest, Histoire en dehors de la salle de classe – expérimentations pédagogiques dans les années ‘90 en Hongrie
Magdalena Saryusz-Wolska, German Historical Institute in Warsaw, Educational Expectations. Public Debates about History Films in Poland
Elżbieta Durys, Faculty of Education, University of Warsaw, Felt History: Melodrama and Affect in Educating about the Past in Contemporary Polish Historical Cinema
Discussion : Bénédicte Girault, Université de Cergy-Pontoise, UMR Héritages
15h30-16h00 : Pause café
16h00-18h00 : Usages éducatifs du passé dans une perspective régionale
Présidence : Ewa Tartakowsky, ISP, CCFEF
Edenz Maurice, Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur, Centre d’histoire de Sciences Po, L’enseignement adapté pour les Amérindiens de Guyane : usages et mésusages du passé (1955–1984)
Aurélie de Mestral, Université de Genève, Institut universitaire de formation des enseignants, L’histoire scolaire depuis la Suisse romande : circulation trans-cantonale et poids du passé
Discussion : Emmanuel Saint-Fuscien, École des hautes etudes des sciences sociales, LIER
Pour plus d’informations, contactez deux organisatrices principales :
Ewa Tartakowsky, Institut des sciences sociales du Politique, Centre de civilisation française et d’études francophones de l’Université de Varsovie, etartakowsky@yahoo.fr
Emmanuelle Hébert, Université de Namur, Université catholique de Louvain (ISPOLE)
emmanuelle.hebert@coleurope.eu