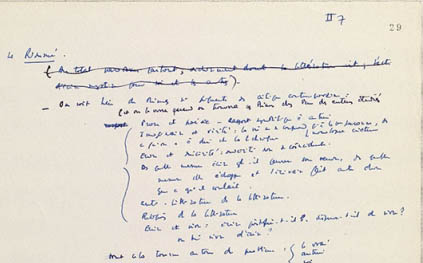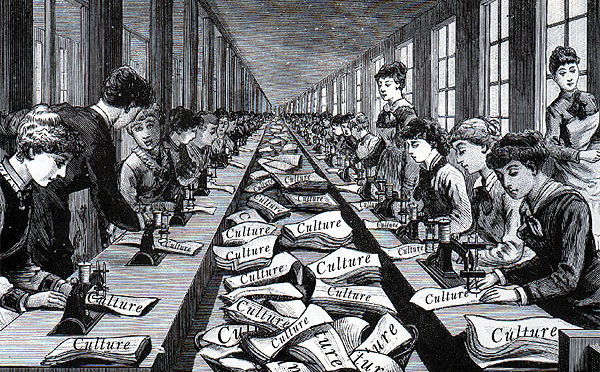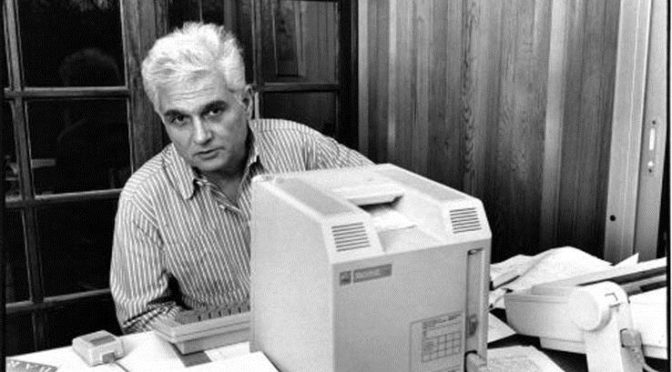Colloque international
Date et lieu : 16-18 septembre 2019, Villa Lanna, Prague
Date limite d’envoi des propositions : 28 février 2019
Organisateurs : Prague Forum for Romani Histories, en collaboration avec le CEFRES
Langue : anglais
Le Prague Forum for Romani Histories de l’Institut d’histoire contemporaine de l’Académie tchèque des sciences publie un appel à contribution pour une conférence internationale consacrée aux migrations des Roms et à leurs mobilités depuis 1945 et jusqu’à aujourd’hui. Le colloque rassemblera des chercheurs d’horizons disciplinaires diverses pour rendre compte à partir d’études empiriques des dimensions multiples des mobilités roms depuis 1945 et analyser les interconnexions existant entre les différentes formes de mobilité des groupes roms par le passé et celles des mouvements récents. La conférence se tiendra à Prague des 16 au 18 septembre 2019. Elle est organisée en collaboration avec le Séminaire d’études roms du département des études centre-européennes de l’Université Charles, la Faculté de sciences sociales et d’économique de l’Université Valle ainsi qu’avec le Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies du United States Holocaust Memorial Museum.
Depuis une dizaine d’années, un nombre croissant de projets de recherche, de publications et de média se sont penchés sur les migrations et les mobilités des Roms. Ces études n’ont néanmoins que rarement envisagé les continuités historiques et les trajectoires sociales qui donnent aux mouvements migratoires leurs formes actuelles. Des études sociologiques et anthropologiques ont rendu compte des stratégies contemporaines des migrants roms, de la construction de classifications et des politiques dont dépendent ces mobilités. Le trope du nomadisme reste présent dans les discussions comme concept fondateur (souvent sous la forme d’un simple lieu commun) que les chercheurs adoptent ou combattent dans leurs argumentations. Nous invitons les chercheurs à remettre en question l’utilité et les limites de cette dualité et à la dépasser en considérant qu’une grande partie des communautés roms appartiennent en Europe à la population sédentaire locale et en analysant à nouveau frais, à l’aide de nouveaux concepts, le mouvement, les circulations et les migrations de l’après-Seconde Guerre mondiale, ainsi que les mobilités sociales et existencielles qui les accompagnent.
La conférence souhaite apporter une contribution au champ de recherche aujourd’hui naissant des études comparées des mobilités roms en portant un regard croisé sur la seconde moitié du XXe siècle. Tandis que les recherches les plus récentes ont mit en lumière les souffrances et les persécutions des Roms durant la Seconde Guerre mondiale, l’après-guerre n’a pas bénéficié de la même attention. C’est le cas, par exemple, de la question du retour des Roms dans leurs foyers détruits, des tentatives gouvernementales de réinstallation ou de dispersion forcées des Roms, mais aussi des migrations internes, de travail ou autres, d’individus en quête d’une vie meilleure et séduits par les multiples opportuniés offertes par les grandes villes industrialisées. C’est le cas encore des trajectoires induites par les « programmes de compensation » mis en place par différents organismes étatiques ou internationaux.
Au sein des minorités persécutées, dont les Roms, beaucoup placèrent l’espoir d’un avenir meilleur dans les projets massifs de restructuration des États européens. En Europe centrale, orientale et sud-orientale, la plupart des Roms, comme d’autres, aspiraient à une plus grande mobilité sociale et une participation entière à la société socialiste. Néanmoins, les projets socialistes d’égalité sociale et d’améloriation du « bien commun » s’accompagnèrent eux aussi de déplacements forcés et de diciplination des corprs pour transformer les membres des communautés roms/tsiganes en citoyens des classes laborieuses.
Les aspirations et les trajectoires des mobilités (sociales) des Roms de l’ouest de l’Europe demeurent elles aussi largement méconnues ainsi que la part des mobilités Est-Ouest des Roms dans l’Europe divisée. Nous disposons encore de peu d’études plaçant les mobilités sociales roms dans le cadre des grandes transformations de l’après-guerre, qu’il s’agisse des relations de genre, des (re)négociation des traditions à l’intérieur et entre les communautés, ou encore des mécanismes et des dispositifs de renégociations identitaires roms, en particulier face aux stigmatisations.
Nous invitons donc les participants à analyser les mobilités les plus variées et la façon dont elles entrent en conflit ou en phase avec l’évolution de ce qui constitue les conditions de ces mobilités, aussi bien comprises comme des mouvements physiques de populations que comme des changements de position sociale. Les organisateurs souhaient initier en particulier une discussion théorique et empirique sur les mobilités comme modes de dispersion et de regroupement entre les mobilités forcées et celles, arrachées au contraire, qui initient des mouvements et des espaces autonomes.
Thèmes et de la conférence
La conférence souhaite rassembler des études ancrées dans des recherches empiriques historiques explorant différents types de mobilités en Europe et au-delà. En plaçant ces mobilités dans un contexte politique, social, historique et culturel élargi, les participants sont invités à rendre compte de migrations volontaires aussi bien que forcées et à dégager des types de mobilités saisonnières ou autres (existencielles, physiques, sociales par exemple) réagissant soit à une oppression soit à l’ouverture de nouvelles possibilités.
Nous engageons en particuliers les personnes intéressées à envisager plusieurs ou une des questions suivantes :
- Les diverses trajectoires et modes des mobilités roms depuis 1945
- Le mouvement comme façon d’échapper à l’oppression ou à l’asymétrie des conditions et de saisir de nouvelles possiblités de mobilité sociale
- Etudes croisant mobilités et différenciations de genre, de classes ou ethniques ou d’autres dimensions de domination sociale
- Les interconnexions entre les mobilités et les formes de violences (physique, symbolique, quotidienne, structuelle)
- Les migrations roms et les politiques socialistes modernistes : les stratégies déployées en vue d’une ascension sociales ; programmes de déplacements et de relocalisations forcés
- La mobilité entre, d’un côté, les politiques d’oppression et les regroupements ou dispersions raciales, et de l’autre la resistance et résilience des individus et des groupes roms
- Les mouvements pour les droits civiques et politiques des Roms et leur relation avec les mobilités sociales et physiques
- Continuités et ruptures dans les migrations : situer les mouvements actuels dans les trajectoires passées des migrations et mobilités
- Les problèmes méthodologiques de l’histoire du présent des migrations et des mobilités roms
- Essai de conceptualisation et de révision critique des migrations et des mobilités au-delà du concept de nomadisme et des tropes étatiques traditionnels ; remise en question des différents modes de vie, au-delà de l’affirmation d’une « promptitude des Roms/Tsiganes au mouvement »
La conférence consacrera un panel aux recherches issues des fonds d’archives de l’International Tracing Service (ITS). L’ITS possède plus de 35 millions de documents datant de l’Holocauste et rassemblant des informations sur le destin de plus de 17 millions de personnes incarcérées, soumises au travail forcé et déplacées durant la Seconde Guerre mondiale. Son fonds concerne aussi les victimes et les survivants roms ainsi que leurs interactions avec les organismes de relocalisations et les programmes de réparation. Les propositions qui présenteraient des recherches menées dans les fonds de l’ITS seront particulièrement prises en considération.
Une session publique sera en outre organisée en coopération avec le US Holocaust Memorial Museum in Washington, DC, au cours de laquelle des experts travaillant sur les fonds de l’ITS présenteront les ressources mises à la disposition du public et aideront les participants et les visiteurs à retrouver des documents concernant leurs ancêtres.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer aux organisateurs Jan Grill et Helena Sadílková une présentation de leur contribution résumée en 350 mots maximum et un court CV de 150 mots maximum d’ici au 28 février 2019. Le comité d’organisation fera part de ses décisions avant le 30 mars 2019. La version écrite des contribution devra être envoyée au plus tard le 1er juillet 2019.
Pour toute information, contacter Jan Grill jan.grill@correounivalle.edu.co, et Helena Sadílková helena.sadilkova@ff.cuni.cz
Composition du comité d’organisation :
- Ilsen About, CNRS, Centre Georg Simmel (EHESS), Paris
- Yasar Abu Gosh, Département d’anthropologie de la Faculté des humanités de l’Université Charles, Prague
- Kateřina Čapková, Institut d’histoire contemporaine de l’Académie tchèque des sciences, Prague
- Celia Donert, Department of History, University of Liverpool
- Jan Grill, University of Valle
- Krista Hegburg, Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum
- Ari Joskowicz, directeur du Max Kade Center for European and German Studies at Vanderbilt University
- Angéla Kóczé, Central European University, Budapest
- Helena Sadílková, Seminar on Romani Studies, Department of Central European Studies, Charles University, Prague
- Eszter Varsa, Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies (IOS), Ratisbonne